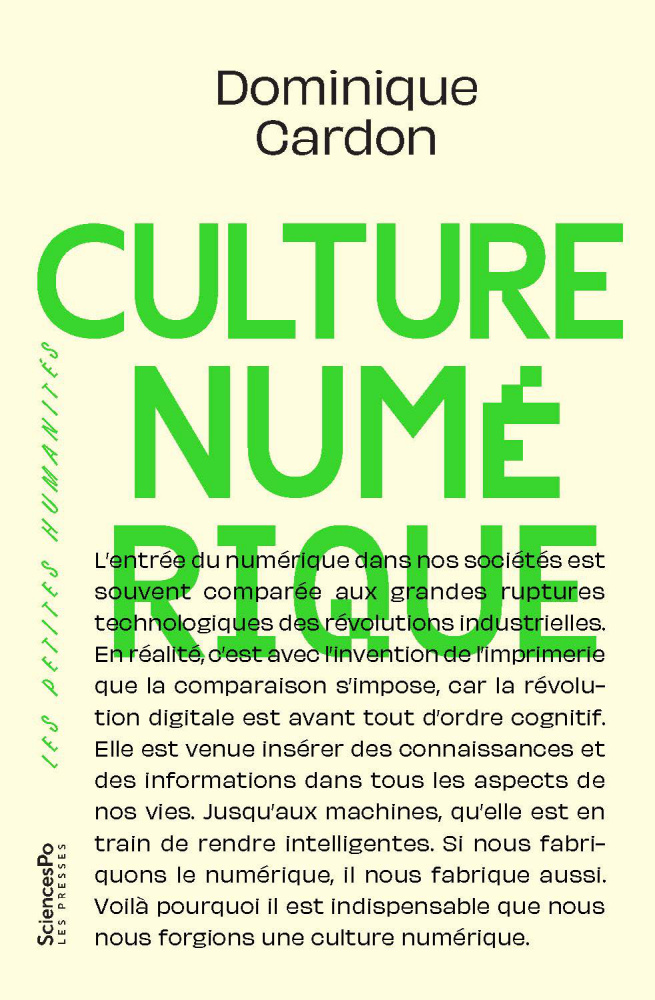
Cardon, D. (2019). Culture numérique. Presses de Sciences Po.
Destaques
Rui Alexandre Grácio [2024]
“(…) révolution numérique est avant tout une rupture dans la manière dont nos sociétés produisent, partagent et utilisent les connaissances.”
“ le numérique est une culture”
“montrer que derrière le bavardage quotidien sur les bienfaits ou les méfaits du téléphone portable, des sites de rencontre, de Facebook ou de la géolocalisation, les mondes numériques ont une histoire, une géographie, une sociologie, une économie, un droit et une politique.”
“car si nous fabriquons le numérique, le numérique nous fabrique aussi.”
“l’esprit de la Silicon Valley : l’innovation est à la fois une solution technique et un projet politique. En Europe, nous avons sans doute cessé de croire à la convergence entre progrès de la technique et progrès de l’humanité, mais ce n’est pas le cas des entreprises de la Silicon Valley. Si nous voulons décoder la culture numérique, il nous faut d’abord comprendre les fondements d’une telle conviction et, pour cela, remonter aux événements qui, dans la genèse d’internet, ont permis de lier le destin de nos sociétés à l’innovation informatique.”
“Pourtant, ce que nous allons appeler dans cet ouvrage « culture numérique » est en réalité la somme des conséquences qu’exerce sur nos sociétés la généralisation des techniques de l’informatique.
L’informatique, pour le dire simplement, est un calcul que nous confions à une machine.”
“ La logique est le langage de l’informatique : dans le processeur d’un ordinateur, les trois fonctions élémentaires, ET, OU et NON, constituent le seul langage que comprennent les circuits de silicium, et c’est avec ce langage simplissime qu’il est possible de faire faire tout ce que l’on veut (ou presque) à une machine.”
“La transformation de l’analogique en numérique est décisive (…).
Or, et c’est la magie du codage informatique, une fois les informations transformées en chiffres, il est possible de conduire l’ensemble des opérations qui sont à l’origine de la révolution numérique : les données peuvent être stockées et archivées dans des fichiers ; elles peuvent être déplacées et échangées et donc favoriser la communication à distance et la coopération ; elles peuvent, enfin, être calculées et transformées de mille et une manières. L’informatique et les ordinateurs sont les agents de ces transformations.”
“En revanche, il est important de comprendre la nature très particulière de l’assemblage à la fois technique, politique et culturel qui prend progressivement forme entre 1960 et 1990 pour donner naissance à ce que l’on appellera internet. Cette histoire a ceci de particulier qu’elle associe, dès sa naissance, le contrôle et la liberté.”
“Dans le jargon des informaticiens, on dit que le web est une couche haute qui utilise une couche basse : le protocole TCP/IP d’internet. Le web est contenu dans internet, mais internet contient beaucoup d’autres choses que le web.”
“L’idée essentielle est celle d’augmentation, qui donne son nom au laboratoire de Doug Engelbart (Augmentation Research Center). Elle est, d’une certaine manière, au fondement de toute l’histoire du numérique. Certes, aujourd’hui, on préfère le terme d’empowerment à celui d’augmentation, mais le principe reste le même : les outils techniques apportent la connaissance, l’échange et la coopération. Ils confèrent aux individus un pouvoir d’agir qui a une dimension politique particulière : celle de les rendre plus autonomes, de les libérer des tutelles et des contraintes sociales très pesantes de la société fordiste des années 1960, d’abolir les distances géographiques.”
“Les premières communautés d’internet qui sont à l’origine de cette idée de séparation entre le « en ligne » et le « hors-ligne » considèrent le monde virtuel plus riche, plus authentique et plus vrai que la vie réelle, et non pas futile, trompeur et dangereux comme le voient les critiques aujourd’hui. Le virtuel, c’est un espace pour réinventer, en mieux, les relations sociales.”
“Cependant, sous l’effet de l’essor des grandes plateformes marchandes, de la fin de l’anonymat en ligne, de la massification des usages du réseau, de la volonté de capturer des données sur le comportement de l’utilisateur, il est devenu de plus en plus difficile de soutenir l’idée d’une coupure entre le réel et le virtuel, entre le monde en ligne et le monde hors ligne.”
“Le travail n’est plus vécu comme une contrainte imposée de l’extérieur en échange d’un salaire, mais comme une motivation intérieure, l’objet d’une passion ; contre la routine, la vie se rêve sous forme de projets collectifs et épanouissants ; plutôt que prôner la discrétion, on invite les individus à s’exprimer et à s’exposer afin de faire valoir leurs singularités.”
“Derrière cette vision quelque peu chimérique d’un monde numérique excitant et créatif, se cachent des mutations sociologiques importantes : les processus d’individuation, la valorisation du mérite personnel à travers le thème de l’égalité des chances, l’augmentation du capital culturel, la perte de confiance dans les formes traditionnelles de socialisation et d’identification statutaire au profit d’affiliations électives, l’accélération et la superposition des expériences grâce aux appareils connectés, etc. Internet n’est bien sûr qu’un élément parmi beaucoup d’autres de ces mutations, mais les technologies numériques leur fournissent une infrastructure particulièrement adaptée.”
“La clé du passage de la société industrielle à la société post-industrielle serait l’augmentation de la productivité liée aux activités informationnelles. À l’économie en dur succéderait brusquement une économie de bits immatériels. À une économie de produits, se substituerait une économie de services, et ces services seraient nécessairement délivrés en ligne.”
“ Toutes les ambiguïtés des mondes numériques se laissent percevoir : avec une infrastructure de réseaux entre individus, on peut faire de la coopération ou du marché. ”
“Dans les médias traditionnels, un contenu publié était vu et, parce qu’il était vu, on considérait qu’il était important. Sur le web, ce n’est plus le cas : on publie d’abord, ensuite le réseau filtre. Certes, les internautes peuvent publier sans en demander le droit aux gatekeepers, mais publier ne veut pas dire être vu. Il existe bien un filtre sur le web, mais il n’est pas binaire, il n’oppose pas les informations que les gatekeepers ont décidé de publier et celles qu’ils ont refusé de publier : le filtre est un continuum entre ce qui est très vu et ce qui est peu vu ou pas du tout vu. Qui sont les gatekeepers d’aujourd’hui, ceux qui désignent les informations à l’attention des internautes ? Ce sont les algorithmes du web, dont nous reparlerons en détail au chapitre 6.”
“Ce phénomène est appelé sérendipité. Dérivé du nom du prince Serendip, le personnage d’un conte ceylanais (évoqué par Voltaire dans Zadig), le mot désigne la possibilité de faire une découverte de façon involontaire, par une sorte de hasard bienheureux. Rien à voir avec le tirage aléatoire d’une bille blanche dans un sac de billes noires : la sérendipité suppose que l’on organise l’environnement afin de réunir les meilleures conditions d’une bonne surprise. Sur les réseaux sociaux, c’est en choisissant les « bons amis » que l’on peut faire des découvertes qui nous surprennent et nous intéressent.”
“ Les discours d’aujourd’hui s’inquiètent du fait que les réseaux sociaux enferment les internautes dans une bulle dont ils ne peuvent sortir, que cette bulle exploite leurs biais cognitifs, qu’ils sont manipulés par les algorithmes des plateformes.”
“Derrière la naïveté apparente de ce constat, se cache une explication sociologique : l’exposition de soi est généralement considérée comme un acte éminemment individuel mais, sur le web, l’identité est largement hétéro-déterminée, c’est-à-dire construite par le regard des autres. L’identité numérique est un processus collectif : les participants montrent d’eux des signes que les autres approuvent plutôt que des signes qui ne retiennent pas leur attention. Leur identité est produite par le réseau “retiennent pas leur attention. Leur identité est produite par le réseau social d’amis qu’ils ont choisi, par leur utilisation de telle ou telle plateforme, par le fait qu’ils s’exposent aux commentaires et aux likes de personnes qui, elles-mêmes, exposent et privilégient tel ou tel trait de leur propre identité. Bref, leur identité numérique n’appartient pas totalement aux individus. Elle est la conséquence de l’espace social dans lequel ils interagissent. C’est précisément le deuxième constat des travaux sur l’identité en ligne : les mécanismes sociaux de la vie hors ligne guident la manière de s’y présenter et de s’y conduire.”
“ Ce processus original n’est pas sans risque. Vu par les individus, il peut être compris comme un facteur d’autonomisation et de réalisation de soi, même si, à l’évidence, certaines formes d’exposition interrogent. En revanche, si l’on considère les plateformes qui collectent les données résultant de l’activité expressive des internautes, l’exploitation qu’elles font de ces données n’a pas grand-chose à voir, semble-t-il, avec l’émancipation des individus, mais beaucoup plus avec le guidage de l’attention et le contrôle publicitaire.”
“L’analyse de cette campagne a toutefois révélé que les outils numériques n’avaient pas servi à faire dialoguer le candidat avec les citoyens, mais principalement à faire circuler sa parole et son image et à mieux cibler les indécis.”
“La politique représentative est en train de se transformer en une industrie de précision, qui créé des fichiers et accumule des données sur les électeurs afin de cibler et d’adapter ses messages aux particularités de leurs profils.”
“Surveiller les individus tout en cherchant à guider et à orienter leurs comportements vers une norme commune : ce système généralisé de notation a de quoi inquiéter à bien des égards. Les notes et avis sont partout sur le web et la réputation est devenue une valeur centrale sur les marchés. Elle est intégrée dans toute transaction en ligne. On note non seulement les livres, les restaurants, les hôtels et les films, mais aussi les vendeurs, les chauffeurs, les compagnies aériennes, les entreprises ou les applications. De façon parfaitement symétrique, dans l’économie des plateformes, après avoir demandé aux consommateurs de noter les vendeurs, ce sont désormais les vendeurs qui notent les clients. La boucle est bouclée : produits, services, vendeurs et clients, tout le monde a sa réputation.”
“De fait, le data journalisme s’est orienté vers un tout autre usage des données publiques, consistant à produire des palmarès dans une logique de services pratiques rendus au public : classement des meilleures écoles ou universités, régions où il fait bon vivre, cartographie des quartiers selon la criminalité, etc.”
“Du côté des usages économiques, on s’est vite rendu compte que l’idée de données brutes était une fiction. Les données ne sont pas des entités naturelles qu’il faudrait extirper des griffes de leurs propriétaires pour qu’elles révèlent leur valeur sur les marchés. Toute donnée est liée à un contexte de production particulier, elle s’inscrit dans une chaîne de traitement spécifique, dans une métrologie destinée à lui faire produire tel ou tel type de signal. Libérée de son contexte pour être examinée dans un autre, la donnée brute risque de ne plus être interprétable.”
“Les big data ne sont rien sans outils pour les rendre intelligibles, pour transformer les données en connaissances. Face aux données massives, nous avons besoin d’algorithmes. Un algorithme – mot dérivé du nom d’un mathématicien perse, Al-Kwharizmi (783-850) – est un ensemble d’instructions informatiques permettant de réaliser un calcul.”
“À la racine de la représentation politique se trouve donc un système sociotechnique dans lequel le choix de “l’algorithme électoral joue un rôle crucial puisqu’il modèle différemment les mondes politiques. Bien que nous n’en soyons pas parfaitement conscients, nos idées, nos engagements, nos représentations ont été en partie façonnées par ce choix préalable.”
“Les algorithmes prédictifs ne donnent pas une réponse à ce que les individus prétendent vouloir faire, mais à ce qu’ils font vraiment sans vouloir se l’avouer. Ces techniques connaissent aujourd’hui une phase de mutation essentielle. La méthode statistique particulière qu’elles utilisent, l’apprentissage automatique (machine learning), a longtemps produit des résultats intéressants mais peu spectaculaires. Or, les progrès récents des machines à prédire bouleversent la manière dont elles pénètrent nos sociétés. De façon surprenante, ces techniques sont aujourd’hui appelées « intelligence artificielle ».”
“ Si l’on voulait être rigoureux, il serait préférable de parler d’apprentissage automatique (machine learning) pour désigner la percée technologique que nous connaissons aujourd’hui et qui est en grande partie une conséquence de l’augmentation des capacités de calcul des ordinateurs (permises par les nouvelles cartes graphiques) et de l’accès à de très grands volumes de données numériques. Parmi les différentes techniques d’apprentissage, l’une d’elle, l’apprentissage profond (deep learning) à base de réseaux de neurones est, en réalité, le principal vecteur de la réapparition du terme d’« intelligence artificielle » dans le vocabulaire contemporain.”
“Qu’est-ce qui n’allait pas dans l’idée d’une machine raisonnant logiquement ? Tout simplement, que le fonctionnement de la pensée humaine est impossible à reproduire. Nous prenons très rarement des décisions à partir de règles de raisonnement que nous saurions expliciter. Nos jugements sont aussi faits d’émotions, d’éléments irrationnels, de spécifications liées au contexte et de toute une série de facteurs implicites ; bref, la décision ne se laisse pas capturer par des règles formalisables.”
“Mais une autre conception, très différente, de la machine intelligente a aussi pris forme au cours de l’histoire de l’informatique : au lieu d’essayer de la rendre intelligente en lui faisant ingérer des programmes, il serait préférable de la laisser apprendre toute seule à partir des données. La machine apprend directement un modèle des données, d’où le nom d’apprentissage artificiel (machine learning) donné à ces méthodes.”
“(…) référence quand on parle aujourd’hui d’intelligence artificielle. Or, elles ont fait des progrès considérables au cours des dernières années, comme le montre le cas de la traduction automatique. Auparavant, on essayait d’inculquer à la machine des règles très sophistiquées qui lui permettent de raisonner comme un grammairien, en connaissant à la fois le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe et un ensemble de dictionnaires de signification appelés ontologies. Au cours des années 2000, IBM puis Google ont changé de stratégie, ils ont enlevé du programme toutes les règles symboliques cherchant à rendre la machine intelligente pour les remplacer par des environnements de calcul statistique très puissants lui permettant d’apprendre à partir d’exemples de textes traduits par des humains. Tous les jours la Commission européenne produit des textes en 25 langues. Les traducteurs automatiques « avalent » tous ces textes pour améliorer leurs modèles. La machine ne cherche plus à comprendre la grammaire, elle fait des scores probabilistes sur les meilleurs exemples.Voilà pour le principe général. Plus précisément, c’est une des différentes techniques d’apprentissage artificiel qui est à l’origine des progrès étonnants que l’on connaît actuellement : la méthode d’apprentissage profond, ou deep learning, qui fonctionne à partir d’une infrastructure dite de réseaux de neurones.”
“mais personne ne sait encore concevoir une intelligence artificielle non supervisée. Les machines sont spécialisées dans le domaine d’apprentissage qu’elles ont appris. Si l’intelligence est la capacité à varier les heuristiques, les cadres d’interprétations et les visions du monde, c’est-à-dire à faire des prédictions de façon non pas modulaire mais méta-modulaire, alors les machines spécialisées n’ont pas cette intelligence.”
“L’audit et la régulation des algorithmes sont des préoccupations grandissantes. Comment et par qui voulons-nous être calculés ? Quel degré de maîtrise et de contrôle voulons-nous avoir sur les décisions que prennent les algorithmes ? Qu’est-ce que nous ne voulons pas les laisser calculer ? Certaines de ces questions sont éthiques, politiques, prospectives, philosophiques et concernent nos choix de vie les plus fondamentaux. D’autres sont concrètes, juridiques et urgentes car non seulement les calculs opérés sur les données numériques sont largement cachés et incompréhensibles mais ils menacent également la vie privée et peuvent être discriminatoires. "
“Une interprétation plus subtile de la prison de Bentham a été proposée par Michel Foucault. L’architecture panoptique a notamment pour vertu que, ne sachant pas si un gardien se trouve dans la tour centrale, les prisonniers intériorisent l’idée d’un gardien fantôme ; ils contiennent leurs pulsions et pacifient leurs comportements pour se plier à une surveillance qui s’apparente, en réalité, plus à un auto-contrôle qu’à une contrainte coercitive. Dans un esprit humaniste et éducatif, Bentham “souhaitait que le pouvoir carcéral transforme la contrainte en auto-contrainte. La grande réussite de l’architecture panoptique, explique Michel Foucault, est de faire disparaître le gardien de la tour. La surveillance n’est plus une discipline centrale, mais un pouvoir capillaire qui se diffuse en chacun de nous pour policer et domestiquer nos conduites. Dans un texte fameux, Gilles Deleuze a décliné ce thème comme celui du passage d’une société de surveillance à une société de contrôle. La surveillance n’est plus un pouvoir extérieur qui nous contraint, elle devient un mécanisme d’auto-contrôle par lequel les individus s’observant mutuellement inhibent leur comportement pour se caler sur les normes de la société.”
“Encore plus qu’une surveillance, c’est un projet de guider les comportements grâce aux données des utilisateurs que façonnent les plateformes numériques.”
“ Si l’individualisation a permis aux logiques de surveillance de s’installer, il nous faut, pour opposer des limites à ce processus, imaginer des réponses plus collectives.”
“Ce livre s’est ouvert sur un ton euphorique avec les pionniers du numérique. Il semble s’achever dans le cauchemar d’une société de surveillance. Les pionniers ont rêvé d’une technologie permettant de mettre la société en réseau, de partager des connaissances et d’en faire des biens communs. Ils ont libéré les subjectivités pour qu’elles s’affichent sur le web, ils ont contribué à élargir l’espace public et favorisé des formes originales d’engagement politique. Désormais, la tonalité des discours à l’égard de la grande transformation numérique est alarmiste. Le web serait marchandisé, surveillé et manipulé par les algorithmes. Les mondes numériques sont devenus un sujet d’inquiétude, ils sont perçus comme un vaste système de contrôle des conduites, un vecteur de pathologies et d’addictions, un Big Brother qui surveille chacun de nos faits et gestes. Loin d’avoir créé de nouvelles libertés, le web serait en fait un nouvel asservissement.Si le changement d’ambiance est frappant, il atteste d’abord la réussite de la grande aventure du numérique dont nous venons de retracer l’histoire. Il est naturel que les anciens aient la nostalgie des premiers temps et qu’ils cultivent le sentiment que c’était mieux avant. La réussite du web a contribué à le massifier. Il est partout, les usages se sont généralisés, sa géographie est mondiale. Le numérique est pluriel et n'appartient à personne. La culture numérique a perdu ce qui faisait son exceptionnalité, son caractère quelque peu aristocratique et inoffensif lorsqu'elle était un espace de jeu réservé à quelques-uns. Elle est devenue ordinaire et commune. En perdant son exceptionnalité, elle a été investie par des forces, des intérêts et des projets, ceux-là mêmes qui traversent nos sociétés.
Si elle semble parfois recouverte par la centralité des grandes plateformes, la vitalité des espaces numériques n’a pas disparu pour autant. Elle ne demande, somme toute, qu’une chose à l’utilisateur : qu’il reste toujours curieux, afin de savoir éviter les grands carrefours de l’information, la première page des résultats des moteurs de recherche et les attractions addictives des réseaux sociaux. Les espaces numériques foisonnent toujours d’expériences originales, innovantes, étranges ou érudites. Nos usages du web restent très en deçà des potentialités qu’il nous offre. Le web se ferme par le haut, mais toute son histoire montre qu’il s’imagine par le bas. Sa trajectoire est émaillée d’initiatives audacieuses, originales, curieuses et en rupture. Il n’y a aucune raison de penser que cette dynamique s’arrête ou qu’elle soit complètement entravée par la domination des GAFA. Plus que jamais, il appartient aux chercheurs, aux communautés, aux pouvoirs publics et surtout aux internautes de préserver la dynamique réflexive, polyphonique et peu contrôlable amorcée par les pionniers du web.”
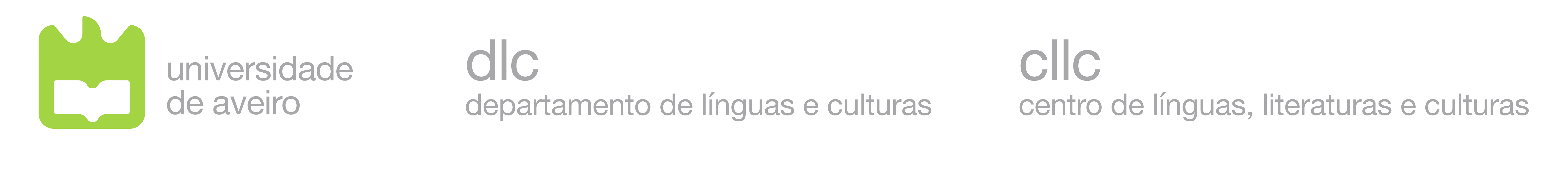
Última atualização em 30 de novembro de 2025