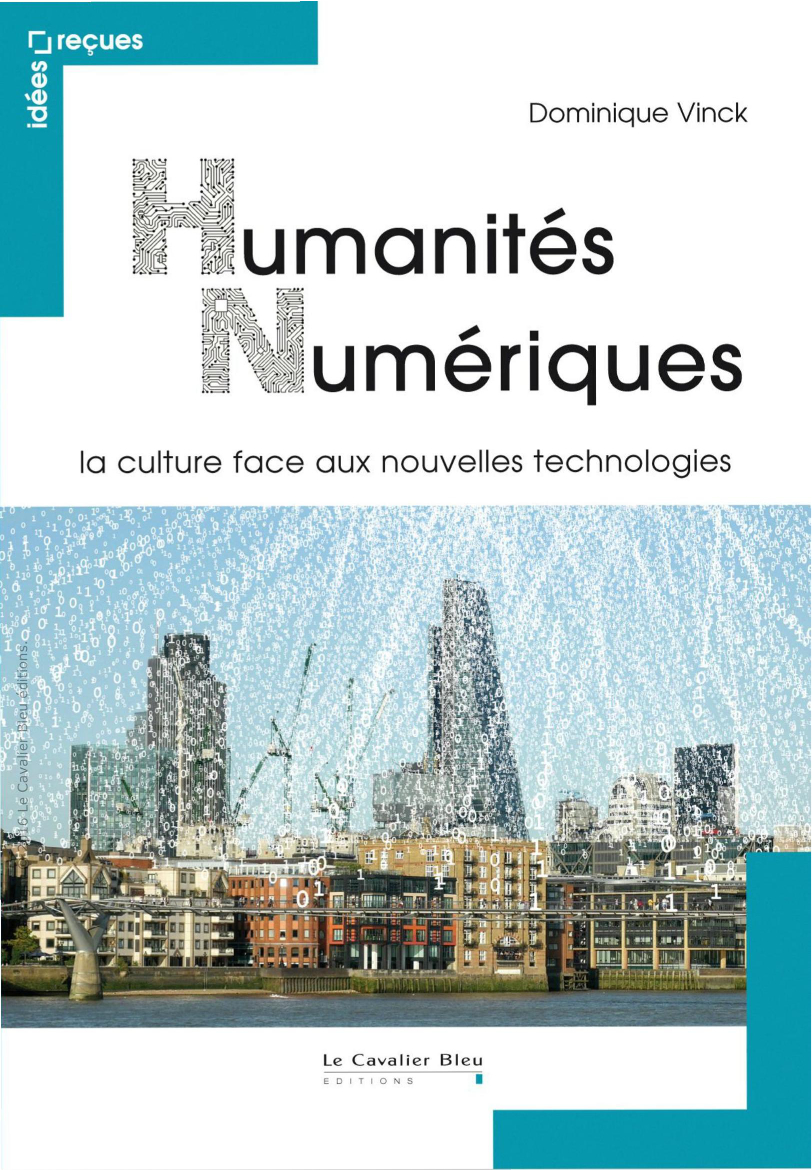
Vinck, D. (2016). Humanités Numériques. La culture face aux nouvelles technologies. Le Chevalier Bleu Éditions.
Destaques
Rui Alexandre Grácio [2024]
«Ensemble des disciplines scientifiques qui s'efforcent de saisir et de formaliser, par les outils et le calcul informatiques, les cultures et les dynamiques sociales, passées, présentes et en émergence. Le terme « humanités » recouvre ici l’ensemble des sciences humaines et sociales (SHS) et les patrimoines et corpus qu'elles traitent. Le terme « numérique » renvoie à l’ensemble des procédés et techniques qui permettent de transformer n'importe quel objet en ensemble de données binaires, les algorithmes informatiques qui traitent ces données (y compris les conserver et en prendre soin) ainsi que les procédés qui génèrent des rendus tangibles des résultats obtenus, notamment sous forme visuelle, sonore ou d’objets physiques. Le numérique déborde donc les seules technologies informatiques. Les humanités numériques renvoient alors à la rencontre des sciences et technologies informatiques et des sciences humaines et sociales.» p. 9
«Le terme « digital humanities » est attribué à John Unsworth, Susan Schreibman et Ray Siemens avec l’édition de À Companion to Digital Humanities en 2004 couvrant à la fois l’utilisation des SHS pour étudier les technologies et pratiques numériques et l’utilisation de ces technologies pour étudier les objets culturels et sociaux. Ce tournant numérique (computational turn) remonte cependant au milieu du XX‘ siècle lorsque les sciences humaines (humanities computing), en particulier les linguistes, les historiens et les sociologues (sociologie quantitative) s’emparent de l’informatique recherche.» p. 10
«Le présent ouvrage traite de ce qui se passe dans le monde aujourd’hui autour des sciences humaines et sociales devenant numériques et de ce qui agite ses acteurs: des problèmes de politique scientifique et culturelle, de création de nouveaux marchés, de rapports d’’hégémonie, de patrimoine et de nouvelle société en train d’advenir mais aussi de débats entre chercheurs.» p. 14
«L’humanisme numérique serait toutefois mal nommé si l’on oubliait que le numérique est fait de techniques corporelles (gestes de lecture avec les doigts et d'écriture, communication et déplacement, etc.), d’interfaces, de codes, de plates-formes, de serveurs de données, d'infrastructure de plus en plus lourdes matériellement et énergétiquement.» pp. 23-24
«Cette dématérialisation suppose de numériser les patrimoines culturels, c’est-à-dire de convertir certains aspects des objets culturels (par exemple, le contenu textuel des livres, la musique gravée sur les disques vinyles, les images conservées sur d'anciennes photos jaunies et cornées ou la forme des poteries) sous la forme d’un ensemble de données numériques (caractères alphabétiques et informations concernant le formatage dans le cas des textes ; tableau des sensations visuelles pour chaque point (pixels) ou série d’instructions pour la compression/décompression ou la vectorisation dans le cas des images) permettant de reconstituer les objets numérisés. La qualité de la numérisation dépend notamment de la finesse de l’échantillonnage (le nombre de points par centimètre carré dans le cas d’une image). Ces codes numériques se traduisent, dans les circuits électroniques, par des signaux (impulsions électriques qui circulent ou modifications de l’état de la matière à un endroit précis, par exemple, dans la mémoire d’un serveur, d’un disque dur ou sur un CD). Ils sont manipulés moyennant des séries d’instructions (programmes informatiques) qui les agrègent, comparent, classent, stockent, transforment, etc. Les programmes informatiques traitent ces informations à grande vitesse ou de façon répétitive (plusieurs milliers d’opérations par seconde). Les dispositifs électroniques et informatiques peuvent ainsi conserver et gérer des quantités colossales d’information venant de la numérisation, puis les traiter par exemple pour afficher des couleurs, des images et du texte sur nos écrans, faire émettre du son par nos enceintes acoustiques ou actionner une imprimante 3D.» pp. 25-26
«(…) la numérisation ne saisit jamais qu'une partie de l’objet numérisé.» p. 33
«La dématérialisation revient à priver une chose de ses attributs physiques dont certains restent importants pour les utilisateurs.» p. 34
«Le mouvement de la « dématérialisation » semble aller de bon train. Il se heurte cependant au fait que numériser ne veut pas dire dématérialiser dans le sens de « priver une chose de tout matérialité ». Si la dématérialisation revient à priver une chose des attributs physiques de son support d’origine, elle consiste en réalité en une re-matérialisation.» p. 35
Parler de dématérialisation devient alors ironique. Certains estiment même que cette dématérialisation ne réduit la consommation ni des matières premières ni d'énergie. Le secteur de l’informatique n’a rien de virtuel : serveurs, antennes-relais, terminaux, câbles transocéaniques, fibres optiques. La demande de ce secteur en métaux a ainsi triplé entre les années 1980 et les années 2010.» pp. 36-37
«Qui dit « numérique » dit chiffre. Les humanités numériques reviennent, de fait, à saisir les phénomènes culturels et sociaux en les transformant en séries de données numériques. Ainsi convertis, les contenus des textes, des images, des films et des interactions sociales peuvent être manipulés par diverses procédures, de plus en plus souvent informatisées.» p. 39
«Au début du xx‘ siècle, les sciences sociales et historiques cherchent à se « scientifiser » en rejetant les interprétations spéculatives au profit d’une approche neutre et objective qui s'appuie d’abord sur des faits et sur la mesure. La quantification est alors investie d’une mission politique consistant à rationaliser la conduite des affaires humaines et désidéologiser les discussions en substituant la mesure et le calcul à l’arbitraire des passions et des rapports de force. Elle crée une nouvelle façon de penser, de représenter et d’agir sur le monde.» pp. 40-41
«Par ailleurs, les algorithmes mathématiques sont euxmêmes des constructions qui reflètent des hypothèses, des intuitions, des préférences, des traditions de pensées, des influences culturelles, des contraintes économiques et des compromis entre chercheurs. Ils ne se réduisent pas à une objectivité qui échapperait à toute dynamique sociétale. Ils doivent eux-mêmes être analysés, décodés et interprétés. Numérisation, quantification et mathématisation ne sont pas seulement des opérations mécaniques consistant à prendre des « données brutes » (les données sont toujours extraites, construites, mises en forme) pour les entrer dans une formule ou une machine qui en dirait la vérité.» p. 45
«Ce travail préalable au comptage est éminemment qualitatif et, dans le cas présent, la quantification suppose un acte politique. Il n’est alors pas surprenant de voir que la quantification a souvent fait l’objet de controverses. Celles-ci tiennent au fait que la construction de conventions d’équivalences engage généralement des négociations et des compromis. (…) La traduction de quelque chose en nombres ne va jamais de soi ; dans tous les cas, elle revient à négliger quelque chose de l’objet, de la personne ou du phénomène ainsi quantifié. Il convient alors de se souvenir de ce qui est perdu au cours du processus de quantification.» pp. 45-46
«Les humanités numériques s’écartent du seul texte pour accorder plus de place à la visualisation graphique, au design, à la mise en scène et à l'expérience spatiale, à la scénarisation et à l'expérience temporelle, au son et à l’image. Ils se rapprochent des plasticiens qui manipulent et déforment des matériaux (ici, des masses de données) leur permettant de mieux les connaître faire des choses chargées de sens.» p. 60
«Des auteurs considèrent que l'étudiant en SHS devrait désormais être capable d'extraire des données du web ou de bases de données, de choisir et de faire tourner des algorithmes, de produire des tables et des visualisations et de les interpréter. La quantification a triomphé dans presque toutes les disciplines des sciences de la nature ; les SHS ne devraient pas y échapper. La prophétie de Le Roy Ladurie concernant la programmation (« L’historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus ») devrait peut-être enfin se réaliser.» p. 62
«Les humanités numériques prônent la coopération interdisciplinaire entre sciences humaines, sciences sociales et informatique, et l'invention de méthodologies hybrides.» p. 63
«En 2010, l’Université d’Albany a même fermé plusieurs programmes de formation en français, italien, russe, lettres classiques et théâtre tandis que d’autres universités « vendent » leurs formations en arguant d’une préparation au marché du travail plutôt qu’une formation à la réflexion et à la citoyenneté. Par ailleurs, des critiques plaident pour une extinction des sciences humaines, disant qu’elles sont un luxe inutile, sans intérêt économique.» p. 73
«Dans ce contexte où les sciences humaines s'inquiètent de leur sort, le numérique est présenté par des universitaires comme le moyen de les sauver d’une mort certaine. Leurs facultés se sauveraient de l’extinction en se tournant vers les technologies numériques afin d’attirer de nouvelles subventions pour la recherche ainsi qu'un soutien de la part de la société.» p. 74
«En outre, le fait d’insister sur les technologies numériques (data mining, text mining) et de dire que les sciences humaines feraient, enfin, de la vraie science comme les autres, loin de les sauver, contribuerait à les dévaluer encore plus, en attribuant tout le mérite de la rigueur conceptuelle et méthodologique aux sciences informatiques et aux technologies numériques.» p. 77
«Les humanités numériques risquent alors de contribuer involontairement à diviser les peuples autant qu'elles cherchent à les unir. Un champ de possibles s’est ouvert; la vigilance collective sera de mise pour qu'elles produisent les bénéfices escomptés.» p. 90
«Si le lecteur est reconfiguré, l’auteur et son autorité aussi. Que reste-t-il de l’auteur lorsque le livre lu est généré en fonction d’algorithmes de l’éditeur, de paramétrages du lecteur et de relations avec d’autres textes et lecteurs ? Ne serait-ce alors pas la mort de l’auteur ?» p. 114
«La numérisation des patrimoines culturels des pays en développement, sous le couvert de leur préservation, constitue aussi une menace de dépossession parce que les versions numériques sont détenues par des institutions ou entreprises du Nord qui en contrôlent l'accès et l’usage, notamment la commercialisation.» p. 128
«Un risque est aussi de voir s’instaurer un contrôle des patrimoines culturels numériques des pays en développement par les pays ou organisations hégémoniques. Le risque est encore accru lorsque des entreprises privées s’en chargent.» p. 130
«On parle de racket culturel, phénomène ancien avec le pillage des pyramides des Pharaons et des Incas, dont les objets sont revendus à haut prix dans les pays développés, y compris auprès des musées publics. Ce racket culturel prend désormais une tournure numérique.» p. 133
«Si la langue est le véhicule privilégié de la culture, qu’en est-il dans le monde numérique et dans la société ? L'influence de l'anglais a cru au cours du xx‘ siècle du fait de la domination économique et politique des États-Unis. Il est devenu la principale langue de communication internationale et contribue à l'instauration d’une forme d’hégémonie culturelle étroitement associé à l’économie libérale et à la globalisation des échanges marchands. Son emploi est parfois considéré comme idéologique ; il marque la modernité et l’ouverture internationale. Il est aussi contesté : résistance à l’hégémonie culturelle par la défense des langues nationales ou du plurilinguisme ; défense d’une langue internationale plus accessible comme l’esperanto ; équité politique (travailler en anglais revient à donner un avantage compétitifà ceux dont c’est la langue maternelle).» p. 135
«Pour être en mesure d'analyser des masses de données (big data, social physics), il convient que les populations soient transparentes et ne s'opposent pas au fait que des experts en data science accèdent à ces multiples traces même si leur traitement est ensuite opaque, dépendant de méthodes controversées, sensible aux failles informatiques et aux vols massifs de données. Le discours qui accompagne ce mouvement dit que seuls les suspects devraient craindre la transparence ; le numérique contribue alors au développement d’une surveillance généralisée des populations.» p. 143
«Ce déploiement du numérique dans le social est tel que bientôt plus aucune activité ne se réalisera sans y intégrer ces technologies, créant une nouvelle écologie sociotechnique et un humanisme numérique.» p. 147
«Des questions se posent toutefois car le numérique peut évoluer de mille façons et toutes ne sont pas équivalentes. Elles ont des conséquences différentes sur nos relations (dépendance, autonomie surveillée, libre consentement), nos projets, nos cultures et nos trajectoires, sur les formes d’inclusion et d’exclusion, sur les hiérarchies et inégalités, sur la force du lien social, et sur l’évolution de l’humanité. Des choix, y compris éthiques, sont devant nous : quelles limites nous donnons-nous à la collecte et à l'exploitation des données sur autrui (individus, communautés et groupes sociaux) ? Nous obligeons-nous à une complète transparence et surveillance mutuelle généralisée ? Quelle place laissons nous aux très grandes entreprises multinationales dans l’orientation patrimoines de nos États de nos comportements, dans la gestion de nos culturels et dans la définition des politiques (recherche, éducation, santé, sécurité, etc.) ? Quels rapports voulons-nous développer avec notre passé et avec les autres communautés humaines ? Comment régulons-nous les méssages (par exemple à des fins d'espionnage) des outils que nous développons en pensant au progrès de l'humanité ?» p. 149
«Les humanités numériques ne sont pas seulement une aventure de lettreux qui se coltinent les outils informatiques ; elles sont surtout un défi posé à la société quant aux cultures numériques et à la nouvelle humanité que nous voulons construire.» pp. 149-150
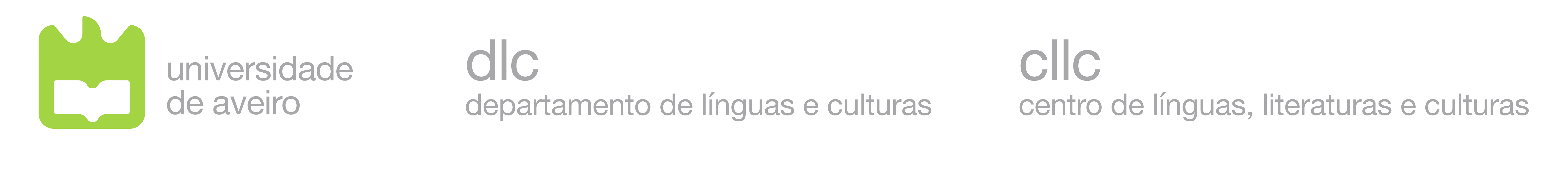
Última atualização em 30 de novembro de 2025