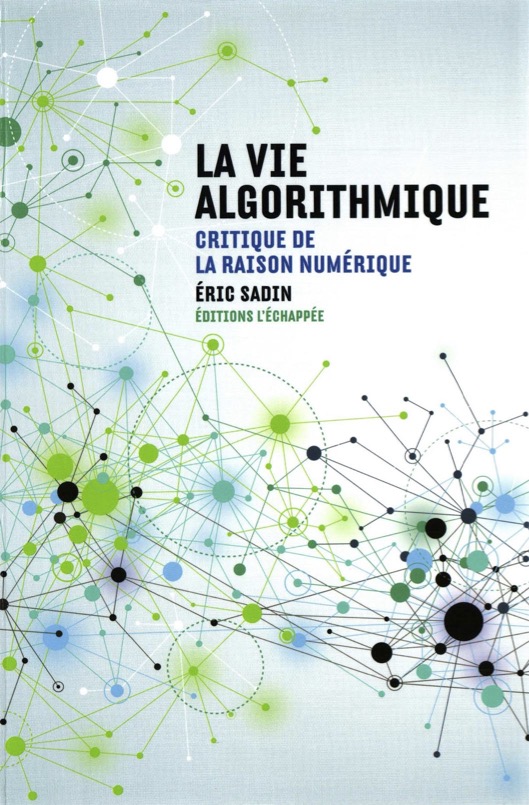
Sadin, E. (2015). La vie algorithmique. Critique de la raison numérique. Éditions de L'Échappée.
Destaques
Rui Alexandre Grácio [2024]
«Car c'est un régime de vérité qui s'institue, fondé sur quatre axiomes cardinaux: la collecte informationnelle, l'analyse en temps réel, la détection de corrélations significatives et l'interprétation automatisée des phénomènes. (…) Les Big data nomment un double processus intégré au sein des mêmes ensembles techniques, qui associe connaissance factuelle et prise de décision suivant des cadences immédiatement enchaînées, à l'image du cerveau humain qui se prononce à tout moment en fonction des stimuli sensoriels du corps. (…) Un« approfondissement cognitif» s'instaure, signalant l'émergence d'une ère de la mesure et de la quantification de toute unité organique ou physique, dépassant le seul cadre d'une connaissance factuelle des choses, pour une évaluation qualitative et constamment évolutive des personnes et des situations». (pp. 28-29)
«C'est un tournant épistémologique, anthropologique et plus largement civilisationnel qui s'opère et qui, par sa puissance de bouleversement et d'imprégnation, appelle à faire lui-même l'objet d'une cartographie précise de sa lignée généalogique, de ses modalités de constitution, autant que de ses visées déclarées ou implicites. (…) L'enjeu consiste ici à élaborer des outils de compréhension portant sur des procédés hautement agissants, orientant une large part de nos existences individuelles et collectives, et qui s'imposent sans que la faculté proprement humaine d'évaluation ou de décision librement consentie ne soit en quelque sorte requise, alors qu'elle renvoie dans les faits à une des exigences politiques, juridiques et éthiques majeures de notre temps». (p. 30)
«La volonté d'ériger des protocoles de traitement automatisé de l'information remonte à une ambition de rationalisation administrative, qui se formalisa à l'origine dans les cartes perforées de recensement des populations à la fin du XIXe siècle, et qui gagna plus tard avec des procédés davantage sophistiqués les champs militaire et du renseignement, jusqu'à imprégner ensuite les activités économiques et financières. C'est cette froide réalité qui aura été étrangement occultée durant les deux dernières décennies du xxe siècle, et dont on aura voulu majoritairement retenir le postulat d'une formidable occasion historique d'affranchissement individuel et collectif». (p. 31)
«Le premier caractère évident du phénomène technique est celui de la rationalité. Sous quelque aspect que l'on prenne la technique, dans quelque domaine qu'on l'applique, on se trouve en présence d'un processus rationnel. [ ... ] Toute intervention de la technique est, en effet, une réduction au schéma logique, des faits, des pulsions, des phénomènes, des moyens, des instruments». C'est cette vérité énoncée par Jacques Ellul il y a plus d'un demi-siècle qui doit être revisitée à nouveaux frais, à la mesure de l'extrême intensification de la tension liant processus techniques et raison implacable du calcul, sensible dans la dénomination même de la notion dont on n'a pas voulu voir la froideur sous le soleil étincelant de la Californie: le numérique, soit l'instauration d'un rapport au réel placé sous le sceau de la puissance objectivante et non ambiguë des mathématiques et des nombres».(pp. 32-33)
«Les Big data, au-delà de toutes les perspectives économiques escomptées, doivent être comprises comme le passage d'un seuil épistémologique et anthropologique, qui veut que nos modes de perception et d'action sur le réel se constituent désormais au filtre majoritaire des données, résultats d'opérations réduisant in fine tout fait à des lignes de code, supposant une définition au chiffre près des situations». p. 34
«L'invention des mathématiques est indissociable de l'aspiration à percevoir les phénomènes sous la plus exacte précision grâce à une «raison pure>> dénuée des contingences sensibles, permettant d'agir en toute conscience sur le concret des choses d'après des grilles d'intelligibilité supposées rationnelles et fiables». (p. 45)
«Ambition qui ne cherche plus à élargir l'accès aux corpus culturels ou aux différents champs du savoir, mais à transformer en information chaque fragment du réel par l'implantation massive et tous azimuts de capteurs. Le projet d'imprégner les substances du monde de puces sensibles vise certes l'érection d'un panopticum électronique destiné à embrasser un état global des choses, mais davantage à rendre possibles de nouvelles postures anthropologiques, fondées sur l'évaluation continue des situations et un ajustement automatisé entre unités organiques et physiques, en vue d'éviter toute perte et de tendre vers une pleine maximisation. C'est la volonté initiale de rationalisation qui est ici puissamment relancée, n'aspirant plus seulement à une organisation partielle des choses, mais qui ambitionne d'instaurer un rapport totalisant aux phénomènes, placé sous la puissance implacable et non ambiguë d'une raison numérique universelle dotée d'un pouvoir de pénétration, de discernement et d'action à terme intégral et infaillible». (p.50)
«Langage universel constitué de codes uniformisés, résultat d'une parcellisation élémentaire des phénomènes susceptible de« faire parler)) tout fragment du monde avec tout autre.
Configuration qui inaugure un rapport tendanciellement totalisant au réel, envisagé comme n'ayant plus d'échappatoire, de« case vide)), pouvant être appréhendé non seulement à partir de chacun des points singuliers quile composent, autant que sous des relations indéfiniment combinatoires entre eux. (…) Mode de perception qui s'apparente à une omniscience divine, affectée d'un pouvoir d'entendement transcendant les conditions usuelles de l'expérience telles que définies par Kant au XVIIIe siècle.
Ce fait majeur d'une codification universelle interopérable n'est pas encore saisi dans toute sa portée, et correspond à une sorte« d'esperanto de la donnée». L'unité binaire, par sa nature rudimentaire, aura contribué à établir une forme d'équivalence entre toute substance, dénuée de relief, de hiérarchie, de catégories de jugement. L'état d'un pneu recouvre la même valeur brute que l'échographie d'un fœtus. Le monde peu à peu se redouble en un plan ininterrompu et indifférencié de chiffres». (pp. 56-57)
«La datification correspond au principe épistémologique en devenir qui veut que le monde s'institue comme une sorte de MÉTA-DONNÉE unique et universelle. (…) La datification suppose un rapport de granularité établi avec les faits. La granularité définit le plus petit niveau de détail géré par un système, produisant un découpage distinctif au sein de masses de data.». (p. 59)
«Condition épistémo-anthropologique qui inaugure un régime d'expérience orienté ou guidé par des équations mathématiques supposées gérer sous la plus haute efficacité chaque occurrence spatiotemporelle. C'est au filtre de l'« exactitude algorithmique» que s'institue désormais le cadre d'intelligibilité et d'agissement individuel et collectif. Dimension performative de ce savoir par la force de sa puissance, et qui réalise comme miraculeusement ou parfaitement l'ambition ancestrale de maîtrise sur le cours des choses». (p. 60)
«C'est la notion de «temps réel» qui subit une modificati on, ne correspondant plus seulement à ce qu'elle nommait au cours des années 1980, soit des modes d'accès ou de manipulation de l'information qui se réalisaient simultanément et sans retard au déroulement des procédés techniques qui les rendaient possibles. Elle nomme tout autant et dorénavant des architectures qui mêlent au sein de mêmes systèmes l'interprétation automatisée des situations et la prise d'initiative en fonction des résultats, soit par des robots numériques, soit par des humains. (…) C'est la notion cybernéticienne de feedback qui emporte avec elle l'ensemble de notre condition, situant le cadre général de l' expérience au sein de mécanismes immédiatement rétroactifs, délaissant progressivement le sensible, le délai réflexif proprement humain, au profit d'un infléchissement quasi instantané des comportements opéré au prisme d'équations algorithmiques.». (pp. 66-67)
«C'est le passage du biopolitique -entendu comme une forme d'exercice du pouvoir portant sur la préservation de la vie des populations-, vers un BIOHYGIÉNISME ALGORITHMIQUE qui s'instaure, déterminant les comportements via des systèmes hautement lucratifs à la fois normés et personnalisés, qui dans les faits poussent à une gestion performancielle de soi». (p. 91)
«Forme d' omniscience computationnelle appelée à progressivement ordonner l'action individuelle et collective, qui réalise comme parfaitement la longue aspiration, manifestée depuis la Grèce antique, à soumettre dans la praxis nos rapports au monde à la vérité indubitable ou implacable d'une stricte et pure rationalité abstraite». (p. 97)
«Un nouveau genre de connaissance émerge, fondé sur une récolte informationnelle massive, soumise à des recoupements corrélatifs identifiés par des algorithmes chargés de détecter des récurrences significatives. Formule heuristique qui renvoie au Data mining à l'œuvre depuis le début de la première décennie du XXIe siècle, qui inaugura le principe d'une divulgation robotisée de phénomènes jusque-là non directement détectables par la conscience humaine». (p. 102)
«C'est toute l'épistémologie occidentale établie sur les traditions platonicienne, cartésienne, kantienne, ainsi que le principe de la connaissance scientifique telle que formalisée par Karl Popper, fondée sur l'expérience validée et sa répétition systématique, qui se trouve non pas tant bousculée que dorénavant redoublée par une nouvelle modalité expansive d'intelligibilité du réel» (p. 103)
«Car l'événement épistémologique majeur qu'il faut saisir -décrypter plutôt- au-delà de ces attributs renvoie au fait que tout résultat d'équation est aussitôt appelé à être exploité sous de multiples formes. Modalité d'appréhension à visée exclusivement utilitaire, qui transforme chaque circonstance en graphe capitalisable, ne laissant jamais en repos les états de connaissance, les situant comme la base hautement informée d'actions à entreprendre, inspirées et garanties par la puissance de définition prouvée des processeurs et des algorithmes.« Néo-utilitarisme>> qui renoue avec la philosophie utilitariste de Jeremy Bentham, concepteur du dispositif architectural pénitentiaire à visibilité intégrale, le Panoptique, que la priorité accordée au temps réel renforce et universalise, l'érigeant comme l'acmé d'une relation continuellement fonctionnelle entretenue à un environnement se manifestant sans point aveugle au fil de l'expérience individuelle et collective». (pp. 104-105)
«D'une certaine façon, l'induction corrélative est à l'image de notre temps, empreinte d'une dimension «néohéraclitéenne )), imprimant du sceau d'une perpétuelle transformation et de l'imprévisibilité nos rapports au monde. Davantage qu'un mode de temporalité, le temps réel témoigne de l'avènement d'une condition qui réalise le rêve occidental d'opérer une maîtrise totale du cours des choses, par la capacité d'examiner à flux tendus leur état autant que leur perpétuelle évolution, permettant d'agir sans délai et en conscience au plus près de la substance de la réalité» (p. 106)
«C'estcette marge d'incertitude qui actuellement s'abolit, par le fait de l'usage universalisé de technologies connectées conjugué à l'expansion des capteurs, qui concourt à instaurer un témoignage à l'égard de gestes toujours plus variés du quotidien, induisant des modalités d'appréhension sans cesse différentielles se déployant au cours du temps. Principe qui, au-delà de l'identification des faits et de leur localisation, autorise des mesures multi-sources continuellement évolutives qui revêtent un pouvoir comparatif, exposant des résultats ne portant plus sur la seule quantité mais sur la qualité. (…) Formule qui représente une forme de perfection du principe de la mesure, relevant d'un ordre à la fois hautement détaillé, contextualisé, synchronique, diachronique et perpétuellement dynamique, correspondant à un régime d'appréhension inédit: QUANTOQUALITATIR.»
Des domaines d'activité toujours plus nombreux sont désormais soumis à des processus évaluatifs».(pp. 113-114)
«C'est aujourd'hui que le régime numérique et son «bornage algorithmique» manifestent pleinement leur vérité, dans leur récente capacité à mesurer la nature composite et transitoire de toute chose, et à les soumettre à des objectifs utilitaires préétablis, faisant de cette disposition même une nouvelle condition d’existence». (p. 117)
«Le concept de sécurité prédictive est particulièrement emblématique de cette inclination contemporaine à vouloir et à pouvoir désormais devancer les risques avant leur éventuel accomplissement». (p. 118)
«Car il est temps de rappeler que l'intelligibilité numérique des phénomènes évince une dimension fondamentale, celle qui échappe à toute réduction binaire: le sensible. Le sensible caractérisé par l'impossibilité de le soumettre intégralement à des catégories, car constitué d'ambiguïté et de formes d'appréhension individualisées, irréductibles à tout principe normatif universalisé». (p. 127)
«C'est la nature de ce savoir qu'il faut identifier ou déconstruire et qui ne se défera jamais de sa constitution binaire, structurellement limitée à ne saisir que des phénomènes catégorisables. Condition cognitive et épistémologique dont il faut exposer la généalogie et le projet, et dont on voit la mesure éminemment réductionniste et normative qu'elle induit». (p. 129)
«Il faut saisir ici le glissement produit, de l'individualisation historique vers un processus de récupération ou de« ré-embranchement)), qui ne vise pas tant son amoindrissement que sa pleine exaltation, rendant possible le procédé aujourd'hui prépondérant de la recommandation personnalisée robotisée, qui synthétise la sophistication numérique contemporaine. Large ensemble en devenir qui confirme le phénomène récent de la personnalisation de masse et qui, plus encore, signale l' émergence d'une ère du SUR-MESUREALGORITHMIQUE qui agrège de façon singulière la plus grande liberté apparente des individus à des systèmes complexes chargés de continuellement la soutenir et de la capitaliser le plus intensément, sous toutes ses dimensions et sous toutes les formes imaginables». (p. 136)
«Gestion algorithmisée de soi qui suppose encore que les personnes elles-mêmes assurent un relais à l'égard de l'impératif de la mesure généralisée, qui témoigne d'une intériorisation consciente autant qu'inconsciente du primat contemporain de la quantification, mais ici vécu sous un mode apparemment autonome et cool». (p. 147)
«Environnement qu'offraient en théorie ces plateformes, mais dont on n'a pas su voir dès leur émergence qu'elles étaient agencées et détenues par des firmes privées qui, au -delà de leur apparence affichée de convivialité, ne visaient qu'à capter le plus intensément l'attention des membres en vue de leur plus haute monétisation». (p. 149)
«Ce n'est plus seulement la décision humaine que nous déléguons progressivement à des systèmes, c'est également une large part de notre perception qui est vouée à être ordonnée par des algorithmes». (p. 157)
«L'ère de la personnalisation robotisée signale l'agonie ou la fin de la société, entendue comme un ensemble intégrant chaque subjectivité singulière au sein d'une large entité composite, supposant de facto des règles, des liens, des différences et des conflits». (p. 160)
«C'est cela le datapanoptisme, un entrelacement toujours plus« intime)) entre les êtres et des algorithmes qui induit indissociablement une connaissance sans cesse approfondie des personnes, des faits et des choses, autant qu'une régulation automatisée du champ de l’action». (pp. 172-173)
«Car ce qui se joue ici, c'est l'universalisation de l'idéologie de l'expressivité, qui appelle à multiplier la publication en ligne de commentaires et d'images, comme si la subjectivité contemporaine se sentait pauvre ou incomplète si elle n'était pas prolongée par le récit indéfiniment maintenu de ses différents états à l'attention des autres». (p. 175)
«Big Brother est mort, mais Dieu existe bien, non pas sous une figure monothéiste, mais d'après une forme universalisée et diffuse d'esprit panthéiste, qui imprègne tous les atomes, connaît toutes les substances ou se confond avec chacune d'elle. Cette forme-là de divinité existe bien, elle renvoie à notre condition contemporaine en devenir et en perpétuelle consolidation». (Pp. 189-190)
«La temporalité de l'action politique se compresse, ne s'accordant plus la distance nécessaire à la réflexion et à la maturation, pour se calquer subrepticement sur le principe de la circulation des flux numériques à la vitesse de la lumière et de la réactivité sans délai à l'œuvre dans les réseaux. Dimension qui atteste de l'imprégnation insidieuse du politique par une technique qui ne travaille pas frontalement à sa désagrégation, mais qui de facto étend de partout son influence agissante par la nature de ses productions et leur diffusion planétaire. Dorénavant, la puissance de gouvernementalité sur les êtres et les sociétés se situe principalement du côté de l'industrie du traitement massif des données, qui représente le cœur d'une nouvelle forme prégnante et expansive de pouvoir: le TECHNO-POUVOIR». (p. 198)
«Enfin le techno-pouvoir contredit l'idée postmoderne qui affirmait, à la suite de Michel Foucault, que le« pouvoir est partout», se nichant en creux au sein de toute relation. Sa forme prépondérante contemporaine est identifiable et localisable, formalisée dans les groupes économiques de l'Internet et du traitement des data. Non seulement le pouvoir n'est pas partout, mais sa source, son cœur, peuvent être aujourd'hui précisément pointés: ils se situent dans les laboratoires de recherche animés par les rêves sans limite des ingénieurs». (p. 203)
«Le terme de back office, qui nomme l'instance qui en arrière-plan règle les procédés, doit être élargi à toute l'industrie de l'électronique, qui opère à l'abri de tout regard ou de tout procédé standardisé de consultation ou de vérification». (p. 210)
«Or, c'est exactement en s' appuyant sur ce socle d'ignorance que le techno-pouvoir peut aujourd'hui aisément développer ses stratégies de façon masquée et sous des atours attrayants et ludiques, dissimulant nombre d'intentions peu avouables, notamment celles qui visent à mémoriser et à monétiser la connaissance des comportements des individus». (p. 214)
«Ce qui assoit la puissance autant que la légitimité du technopouvoir contemporain, c'est d'abord le dogme de l'innovation, désormais entendue comme étant la condition primordiale supposée garantir la viabilité présente et à venir des sociétés. (…) Le techno-pouvoir est un techno-capitalisme, soit un capitalisme qui exploite autant que possible les potentialités aisément exploitables offertes par les technologies numériques, et qui exalte comme jamais ce processus de« destruction créatrice»». (pp. 215-216)
«Ce qu'aura institué le techno-capitalisme à échelle globale, c'est un mode de rationalité fondé sur la définition chiffrée de tout phénomène grâce à la puissance indéfiniment accrue du computationnel» (p. 219)
«C'est la production d'un contre-imaginaire, dans l'esprit et dans la langue, qui doit être déployée. À cet égard, il conviendrait de ne plus accepter les vocables et notions vite entendus, les techno-discours, et les soumettre à de nécessaires examens critiques. Il relève d'une urgence de fabriquer de nouvelles formes de contre-cultures, celles de notre temps, capables de faire valoir de partout dans la pensée et la praxis, du minoritaire et du différent, du différend autant que du divergeant (…)». (p. 234)
«Or, c'est précisément contre cette tentative d'alignement du travail de la raison et de la pensée à la vérité de «chiffres qui parlent d'eux-mêmes» qu'une partie des sciences humaines doit se développer, en vue de s'opposer à ces assauts réductionnistes, d'analyser les conditions de production de tels discours, autant que de celles qui participent sous de multiples formes de l'instauration de modes de rationalité strictement utilitaristes». (pp. 240-241)
«Nous savons, preuves à l'appui, depuis les travaux de paléontologie menés par André Le roi -Gourhan, à quel point les artefacts développés par les humains depuis la préhistoire n'ont cessé d'opérer des effets de rétroaction sur les gestes, les comportements, les postures corporelles, allant jusqu'à interférer sur les structures du cerveau. Les instruments techniques ne répondent pas seulement à des fonctionnalités précises, ils déterminent depuis des millénaires une anthropologie continuellement enchevêtrée à des prothèses externes. Aujourd'hui, nous saisissons que la technè contemporaine a intensifié sans commune mesure cette faculté d'imprégnation sur les individus et les sociétés. Alors que les technologies numériques régissent un nombre sans cesse extensif de nos activités, modifiant jusqu'au cadre de la cognition humaine, elles n'ont pas fait jusqu'à maintenant l'objet d'examens éthiques à la mesure de leur puissance d'influence indéfiniment croissante. Une éthique de la technique a manqué au cours de l'histoire et manque à notre présent.
Une décorrélation s'est maintenue entre la technique et l'éthique, comme si la fascination exercée par les inventions humaines depuis la Chine ancienne, la Grèce antique, durant les Lumières et jusqu'à nos jours, avait occulté la portée de leurs incidences sur l'ontologie humaine» (pp. 246-247)
«Refuser de se soumettre passivement à ce régime restrictif exige de développer des temporalités contradictoires ou divergentes ne s'alignant pas sur l'axiome de la« destruction créatrice» perpétuelle. Postures qui témoignent du désir de vivre à «contretemps», conformément à la notion nietzschéenne d'inactuel qui signale la possibilité d'observer les faits à la distance critique nécessaire et de se démarquer d'un régime normatif dominant (…)». (p. 258)
«Si ce mouvement technico-économique continue de se déployer selon les mêmes courbes exponentielles, deux phénomènes alors s'imposeront massivement. D'abord, celui qui consistera à généraliser un régime d'efficacité fondé sur la réalisation la plus immédiate de toute action calquée dans les faits ou comme point d'horizon sur la vitesse des processeurs. Ensuite, celui qui marginalisera de facto l'activité humaine en regard de la puissance sans cesse accrue acquise par les systèmes cornputationnels. C'est la place de l'être humain autant que notre liberté qui sont appelées à être amoindries par des protocoles dotés de la faculté d'initiative et dictant la forme des choses en fonction d'algorithmes visant systématiquement l'optimisation de toute situation». (p. 259)
«La collusion à l'œuvre depuis plus d'un siècle entre un mode de rationalité prioritairement fonctionnaliste et les techniques computationnelles est aujourd'hui non seulement patente, mais atteint son acmé, imposant une raison numérique fondée sur un découpage et une mémorisation de tous les actes de la vie. Acceptons-nous d'être toujours plus intégralement régentés par ce mouvement qui s'intensifie et se perfectionne à des vitesses exponentielles, ou sommes-nous décidés à opposer des logiques fondées sur de tout autres exigences aptes à favoriser la faculté humaine de libre choix et la subjectivation des existences? Il s'agit là d'un enjeu et d'un défi pratique décisifs, dont notre degré de réponse individuelle et collective définit d'ores et déjà la nature de notre présent et déterminera celle de l'humanité à venir. La tension entre ce mode de rationalité devenu quasi exclusif et la technè contemporaine, qui participe avec force de sa consolidation et de son expansion, doit faire l'objet de débats et de controverses publiques. Ce compagnonnage qui détermine toujours plus profondément la forme du monde et celle de nos expériences doit sans cesse être analysé, décrypté, et plus que jamais défait vu son pouvoir unilatéral et indéfiniment accru de gouvernementalité, se soustrayant de surcroît à toute délibération démocratique. Raison pour laquelle la politisation à de multiples échelles de nos rapports aux technologies numériques renvoie in fine à la question du mode de vie que nous souhaitons adopter et à la nécessaire vigilance à maintenir à l'égard de systèmes robotisés ordonnant toujours plus profondément la trame de nos existences. En cela, soumettre la vie algorithmique contemporaine à une critique en acte de la raison numérique qui l'ordonne relève d'un combat politique, éthique et civilisationnel majeur notre temps». (p. 261)
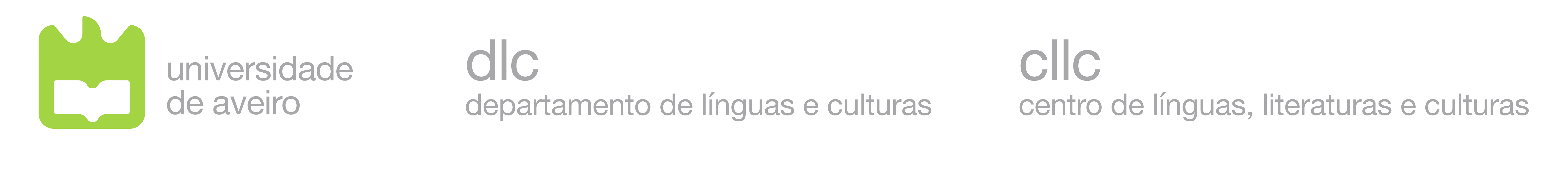
Última atualização em 30 de novembro de 2025