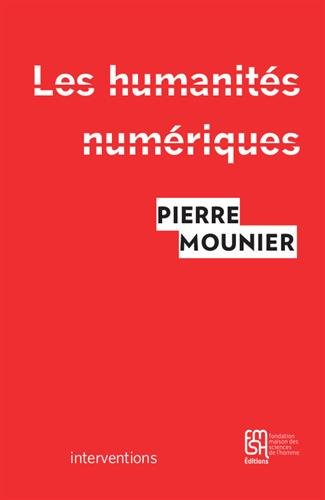
Mounier, P. (2018). Les humanités numériques. Une histoire critique. Éditions de la Maison dês sciences de l’homme.
Destaques
Rui Alexandre Grácio [2024]
Introdução
A questão transversal que se coloca é a de saber como encarar o futuro das humanidades numa sociedade dominada pela ciência e pelas técnicas. Pergunta-se, pois, se a grande «cruzada digital» (p. 11) levará a uma refundação das humanidades?
O aparecimento, desde 2000, da expressão «humanidades digitais», significa essa reformatarão do campo às novas exigências da migração para o digital? Trata-se, enfim, de saber como realizar o interface das humanidades com o digital, não deixando que as primeiras percam os seus traços distintivos e não sucumbam à ideologia da ciência e da tecnologia (um tema retomando num dos capítulos posteriores do livro). Segundo o autor, elas enfrentam assim um triplo desafio: o desafio da relação com a técnica, o desafio político e o o desafio científico. No que diz respeito a este último, Mounier escreve que
«En passant des sciences humaines aux humanités numériques, c’est toute la relation des humanités aux sciences qui est redéinie sur des bases qui ne sont pas celles d’une convergence directe, mais plutôt d’une mutation plus générale du fait de l’utilisation universelle des technologies numériques.» p. 17.
Como exemplo de resistência e de tentativa de preservar os traços específicos das humanidades, o autor refere os trabalhos de Johanna Drucker e o seu conceito de «computação especulativa». Citando:
«Ce faisant, les humanités retrouvent une dimension critique qu’elles pouvaient avoir tendance à perdre en se faisant sciences humaines. Elles peuvent à la fois interroger des interactions sociales et des pratiques culturelles désormais majoritairement sous influence technologique, et en même temps proposer d’autres usages possibles des technologies numériques ; ce que Drucker appelle « speculative computing».»
Ou seja, mais do que falarmos de humanidades digitais, a questão mais importante é ter uma perspetiva crítica sobre elas. Isso não significa que não as acolhamos, mas sim que temos de ter um olhar atento às transformações que propõem e às direções para onde nos conduzem.
Para este fim, propõe o autor no final desta introdução
«Définir la place que les humanités doivent tenir dans notre époque implique d’en redéfinir le contrat social et épistémique. La première étape de ce travail de longue haleine passe donc par une histoire critique du mouvement de développement des humanités numériques dont les racines sont aussi anciennes que l’informatique elle-même.» p. 18
Introduction IBM ou International Busa Machines ?
De l’informatique aux humanités
Neste capítulo começa-se a contar a história mais recente das humanidades digitais através do encontro do Padre Roberto Busa e o fundador da IBM, Thomas J. Watson. Em muitos aspetos trata-se de uma história exemplar.
O Padre Roberto Buso era um jesuíta estudioso da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Como se escreve no livro:
«Selon Aurélien Berra, un des spécialistes français de ce domaine de recherche, « Busa souhaitait étudier le vocabulaire de la présence, de l’incarnation dans les œuvres de Thomas d’Aquin, ce qu’il ne pouvait pas faire en se contentant de rechercher des occurrences de substantifs. Il devait aussi, dans les millions de termes de son corpus, s’intéresser à un mot comme la particule latine in, “dans”. La compilation et l’usage d’un index complet constituaient un travail surhumain. La lecture intensive traditionnelle ne pouvait pas suiffe. La concordance automatique était la solution».
Ou seja, para realizar a tarefa pretendida, seria preciso de algum modo digitalizar o texto e tornar viável a contagem de ocorrências para a partir daí proceder a uma análise. Era precisa introduzir e recorrer ao cálculo para aceder a uma outra leitura do texto. De certa maneira, a ideia de «close reading» estava aqui a dar lugar à ideia de «distant reading». Não uma compreensão do texto baseada na exploração exaustiva do sentido, mas uma explicação baseada nos dados e no cálculo.
É interessante a maneira como o autor do livro descreve o encontro, até porque ainda estamos numa era de cálculo através de cartões perfurados:
«À la suite d’un voyage aux États-Unis en 1949, le père jésuite entame un patient travail de transcription de la Somme théologique sur support informatique, travail qui lui prendra plus de trente années. Dans les États-Unis de l’après-guerre, c’était incontestablement l’entreprise IBM qui était la plus avancée dans le traitement automatique de l’information, avec sa toute nouvelle machine, le SSEC – Selective Sequence Electronic Calculator. Ce n’est pourtant pas cette machine qu’utilise le Père Busa mais plus modestement des machines à cartes perforées dont la firme dominait la production et qui étaient utilisées dans de nombreux secteurs de la société. Le travail consiste alors à « coder » par perforation chacun des mots de l’œuvre de Thomas d’Aquin sur autant de cartes, de même que sa position dans le corpus ainsi constitué. Le positionnement des trous efectués dans la carte permet ensuite aux machines de traitement de sélectionner par procédé mécanique toutes les cartes ayant des caractéristiques similaires, ce qui permet de compter le nombre d’occurrences des diférents mots et leurs différentes formes, ainsi que d’établir un index pour en situer les différentes positions dans le texte.
L’Index thomisticus, le résultat de cette entreprise de grande ampleur publié en 1980, comporte pas moins de 70 000 pages réparties en 56 volumes. Bien que le programme de recherche de Roberto Busa ait été initialement conçu en théologie et philosophie, ses applications les plus évidentes ont fondamentalement changé une autre discipline en apparence éloignée de la sienne : la linguistique.» p. 22-23
E, mais adiante:
«Cette approche utilise l’informatique non pour faciliter ou accélérer le travail du chercheur, mais pour conduire l’analyse à un niveau jusqu’ici inaccessible, permettant de proposer des interprétations inédites. En l’occurrence, le père jésuite efectue une opération d’un type nouveau : son travail ne consiste plus seulement à lire le texte, mais à l’observer comme objet, préfigurant le concept de « distant reading » proposé par Franco Moretti plusieurs décennies plus tard.» p. 24
Este encontro revela-se decisivo
«C’est lors de la rencontre entre les deux hommes que l’investissement d’IBM dans l’aventure théologico-linguistique est décidé.» p. 25.
E esta aventura direcionará uma das linhas de desenvolvimento que passará futuramente pela tradução automática, pela lexicometria, pela estilometria, etc.
Um ponto importante que o autor coloca em destaque é a ligação dos projetos da IBM na continuidade da 2.ª Guerra Mundial, a qual conduz a uma
«machinisation croissante de la vie quotidienne du fait de l’organisation rationnelle du travail, de la mécanisation des moyens de production et de l’automatisation de nombre de tâches.» p. 28.
Em suma, o avanço da «fascinação pelo quantitativo» (p. 36) vai desembocar na dupla ideia de dispor de dados, de converter a realidade em dados e, ao mesmo tempo, codificar a informação para a poder tratar automaticamente.
«il ne s’agit plus dans ce dernier cas d’automatiser des actions, mais bien de coder l’information pour pouvoir la traiter automatiquement.» p. 37.
Isso vai tornar, naturalmente, a informação como o grande negócio do século XX. É que com o tratamento automático da informação alcançamos a capacidade, não só de medir, mas de prever e controlar. A velha vocação que alia o saber, o poder e o controlo emerge aqui com esplendor.
Poderemos dizer que se trata de uma mudança de paradigma relativamente a uma certa visão de conhecimento, que apesar de ter por objetivo a ideia de conhecer para poder, seguia um outro caminho (o método experimental). Com a viragem digital, ou seja, a conversão da realidade em dados susceptíveis por serem tratados por modelos matemáticos, é de outra coisa de que se trata:
«Il s’agit de mieux connaître bien sûr, ou plutôt de connaître diféremment, dans la perspective de mieux administrer, manipuler, transformer des populations, des objets de consommation, des forces de production, des moyens inanciers, des textes.» (p. 41).
Neste processo, a estatística ganha uma relevância grande, mas opõe-se ao espaço do debate:
"Ainsi, pour Desrosières, « la constitution d’un espace rendant possible le débat contradictoire sur les options de la cité suppose l’existence d’un minimum d’éléments de référence communs aux divers acteurs : langage pour mettre en forme les choses, pour dire les ins et les moyens de l’action, pour en discuter les résultats. Ce langage ne préexiste pas au débat : il est négocié, stabilisé, inscrit, puis déformé et défait peu à peu, au il des interactions propres à un espace et une période historique donnée»". p. 42
«La statistique devient progressivement un langage de représentation de la réalité sociale à la frontière de la connaissance et de l’action, outil de connaissance pour les sciences sociales, outil de négociation et de pouvoir pour les autorités administratives et politiques. Le développement des humanités numériques par l’utilisation intensive de machines descendant en droite ligne de celle inventée par Hollerith répond-il aux mêmes enjeux à la fois scientifiques et politiques, concernant, cette fois, non plus la représentation des populations et de leurs caractéristiques mais celle des textes et plus largement des productions culturelles qui sont l’objet d’étude même des sciences humaines ?» (p. 43)
Ce que l’ordinateur apporte aux humanités
Neste capítulo trata-se de ver as transformações e os desafios que o uso dos computadores e da informática traz às humanidades.
Poderíamos dizer que, voltando a ideia da «distant reading», aquilo que a possibilidade do cálculo traz é o tratamento em grande escala. A grande escala, em termos digitais, recebe o nome de Big Data, ou seja, grandes aglomerados de dados, como por exemplo aqueles que foram gerados pela Google no seu projeto de digitalizar todos os livros do mundo. Sem entrar aqui em detalhes, uma análise desses dados massivos só pode ser feito por máquinas cujo processamento seja capaz de os tratar. Mas, por outro lado, permite um acesso a um novo «corpus» que anteriormente não era acessível. Por exemplo, e isso é referido no texto, pode lançar-se a ideia de estudar a literatura mundial no seu conjunto.
Claro que as análises realizadas por esta via vão implicar modelização, formalização, estabelecimento de padrões, construção de cartografias. Mas, como nota o autor a propósito destas últimas, «Mais en réalité, plus que la géographie c’est la géométrie qui l’intéresse dans l’essai cartographique.» p. 55.
Estamos aqui perante uma nova forma de encarar a teoria (e o autor voltará ao tema) e, ao mesmo tempo, de uma clara preferência do modelo da explicação (ciências da natureza), sobre o modelo da compreensão (humanidades). É claro que houve resistências a este movimento e o acento colocado na importância da interpretação é aqui crucial. De um lado, a pretensão de acabar com a interpretação pela via da lógica e da matemática, ou seja, pelo império do raciocínio formal; do outro lado, a afirmação de uma irredutibilidade da interpretação à sua dimensão lógico-racional.
Pour une critique « humanistique » du numérique
Neste capítulo, dedicado a uma abordagem crítica das humanidades digitais, o autor procura lançar algumas questões sobre estas últimas, começando por indagar sobre a coerência das próprias humanidades. Ele procura saber
«ce qui distingue les humanités numériques des autres disciplines utilisant de la même manière les technologies numériques. Autrement dit : quelle est la part « humanistique » des humanités numériques et quels en sont les usages proprement humanistiques ?» (p. 71)
Um dos recurso a que lança mão é a famosa distinção entre «data» e «capta» , proposta por Johanna Drucker e a que já nos referimos a propósito da «computação especulativa». Para ela, em vez de falarmos de mathesis universal, deveremos falar de aesthesis. Esi algumas passagens interessantes do livro sobre esta tese:
«On voit donc avec Ivanhoe comment Johanna Drucker poursuit le même objectif d’inscription de la subjectivité de l’utilisateur au coeur de la déinition même du texte. Ici encore, l’interface n’est pas seulement une représentation de l’information ; elle en est une instance de recréation puisqu’elle engage la subjectivité de celui qui interagit avec elle.» (p. 81).
«La mathesis universalis est un concept développé par René Descartes dans Les règles pour la direction de l’esprit, en particulier dans la quatrième règle qui pose les principes d’une « science de la vérité » reposant sur l’« ordre et la mesure » selon les mots de Descartes. La mathesis n’est pas, pour Descartes, réductible à ce que l’on appelle aujourd’hui les mathématiques, mais cette discipline en représente l’actualisation la plus proche. En un mot, la mathesis est un moyen d’atteindre la vérité par la « méthode », qui repose chez Descartes sur l’intuition et la déduction. Repris et développé par Leibniz, le concept de mathesis universalis porte chez ce dernier une dimension universelle qui pose les fondements d’une langue universelle capable de représenter les choses telles qu’elles sont. La mathesis cartésienne est communément désignée comme étant au fondement du rationalisme moderne et du développement des sciences modernes comme mathématisation de la nature.
À ce puissant courant de pensée, dont elle voit la résurgence contemporaine dans l’extension universelle du numérique et particulièrement les humanités numériques telles qu’elles se sont développées au XX e siècle, Johanna Drucker tente d’opposer une « aesthesis » qu’elle construit sur la générativité des représentations de l’information et la multiplicité de son inscription matérielle. Ce qu’elle combat particulièrement dans la mathesis telle que l’incarne le numérique, c’est l’« autorité culturelle » qui la soustrait à la critique. Les interfaces informatiques s’imposent d’elles-mêmes comme représentation adéquate de la réalité car elles sont issues de procédures formelles non ambiguës. Toute inadéquation ne peut résulter que d’une erreur corrigible.
Or, plaide-t-elle, cette approche repose sur la possibilité d’une représentation absolue de la réalité, indépendante de toute matérialisation de cette représentation. Pour la chercheuse américaine, il n’existe au contraire que des représentations matérielles, inscrites, générées par des actions, et donc nécessairement partielles, situées, subjectives : «Je vois maintenant que comprendre la conception des projets numériques comme instruments rhétoriques est essentiel à l’analyse critique.» (pp. 82-82)
Assim, contra a herança da ideia de uma lógica que permita o controlo total, a autora propõe uma abordagem materialista
«qui s’attache à analyser les inscriptions de toutes natures dans leur multiplicité et leur variation ininie – comment elles sont engendrées et ce qu’elles engendrent. Elle passe alors du concept de représentation qui ne se conçoit que comme une dégradation – et nous sommes alors dans la longue tradition platonicienne du mythe de la Caverne –, au concept de génération qui regarde la représentation comme une action créative individuelle ou collective dont le moteur est la subjectivité des hommes.» p. 84
Vale ainda a pena citar mais algumas passagens:
«Car si les technologies numériques s’appliquent désormais à tous les secteurs de la vie courante et professionnelle, elles s’accompagnent la plupart du temps de l’autorité culturelle que leur confère leur formalisme logique et qui anesthésie le sens critique des utilisateurs que nous sommes. Dans le domaine de la sociologie des sciences par exemple, alors que Bruno Latour a mis en évidence le fonctionnement du processus d’élaboration d’une vérité scientiique – qui résulte d’un long travail d’inscription et de réinscription, de transmission et de traduction au sein d’un réseau d’acteurs humains et non-humains –, le recours à des modèles mathématiques mis en œuvre par des algorithmes informatiques donne l’illusion d’une infaillibilité du résultat puisque le facteur humain en a été exclu.
C’est en ce sens que l’on peut dire que la méthode « humanistique » qu’elle met en œuvre s’appuie sur un humanisme philosophique qui s’abstient de toute transcendance mais choisit de s’en tenir à la réalité humaine dans la diversité des subjectivités qui s’expriment et se façonnent, incomplètes et partielles. Cela lui permet de développer une position particulièrement critique vis-à-vis du posthumanisme qui prétend corriger et dépasser la faiblesse des hommes par l’infaillibilité du code informatique. Au posthumanisme, elle oppose un « métahumanisme » qui conçoit les médias numériques comme le prolongement et non la négation de l’humain comme espèce douée de sentiments.» (p. 85)
O autor recorre também a um outro autor, Milad Doueihi, que se posiciona criticamente relativamente às humanidades digitais, valorizando (como historiador) a noção de «arquivo». Eis uma passagem interessante:
«Autrement dit, l’activité humaine se déploie sur la base d’un oubli permanent qui lui permet de mettre en relation ses préoccupations contemporaines avec un passé qu’il reconstruit par la mémoire, ce qui en explique la variabilité. Or, avance Doueihi, dans sa quête d’absolu, la culture numérique modifie notre rapport à la mémoire en l’entâchant d’une erreur essentielle : l’«oubli de l’oubli» ; et ce, à deux niveaux : d’une part en prétendant que l’archive numérique est un enregistrement parfait de la totalité de l’information et y donne un accès transparent et neutre, d’autre part, sur le plan des principes, en poursuivant cet objectif inhumain de l’archive totale.
Dans les deux cas, et on aura l’occasion d’y revenir, la mythologie propre à la culture numérique est grosse d’implications politiques particulières qui visent à nier et à éliminer tout principe de variabilité des représentations humaines». p. 91.
A parte final do artigo é dedicada a aspectos de convergência das duas posições críticas apresentadas.
«Tous deux déploient une critique sévère de la prétention à la mathesis, une connaissance parfaite du « Vrai » qui pourrait s’appliquer aux afaires humaines et être déduite a priori, c’est-à-dire très exactement calculée.» p. 93
La fin de la théorie
O nome deste capítulo aponta já para as consequências da viragem epistemológica introduzida pelo digital e que estende à análise digital à cultura. Daí o autor falar longamente da «culturomics» e da introdução de um novo tipo de prova, contrastante com a prova nas humanidades (que não são demonstrativas e comportam sempre subjetividade). Assim, refere
«la rigueur de l’analyse mathématique qui s’oppose à l’impressionnisme de l’analyse critique.» (p. 100).
Aqui não está apenas em causa a pretensão de uma vitória do demonstrativo sobre o argumentativo, está também em causa a passagem do qualitativo ao quantitativo como condição de cientificidade (cf. p. 100).
Uma vez mais retorque-se com a questão da interpretação e com a ideia de que qualquer datificação implica interpretação e também contextualização.
Mas a questão do fim da teoria é esta:
«De nouveau : est-il vraiment nécessaire de les expliquer, ou même de les comprendre, alors que l’établissement de corrélation pourrait être considéré comme suisant ?»
Ou seja, é a própria noção de compreensão e até de explicação são postas em causa. Uma passagem sobre isto ilustra bem a questão:
«Au diable la psychologie, l’économie, la sociologie. Il ne sert à rien de chercher à comprendre le consommateur ; il suit de tracer ses actions, de calculer des corrélations, et d’en user pour lui faire une ofre pertinente. Et ce n’est évidemment pas un hasard si Michel et Aiden ont développé leur projet au sein de la irme, en tant que « visiting scholars ».
On comprend pourquoi ils n’ont pas besoin de plus d’un historien, ni d’un linguiste ou d’un anthropologue pour « observer » la culture. La calculabilité universelle se substitue aux longs détours de la compréhension en profondeur ; elle établit des raccourcis qui permettent d’obtenir directement les réponses aux questions précises, pragmatiques et opérationnelles qui sont posées.» p. 114
E ainda mais uma passagem, num capítulo muito rico e importante para a discussão das humanidades digitais:
«On a oublié cette hypothèse essentielle de Von Neumann et on est passé vers une universalité qui s’articule aujourd’hui autour de l’expression de “raison computationnelle”. On peut dire aujourd’hui que l’informatique est un préjugé occidental qui s’airme partout et modifie notre rapport à la culture, à l’identité, à la langue. » (p. 120).
Les humanités à l’épreuve de la technoscience
Neste capítulo a questão é a da ciência e da tecnologia como ideologia, um tema abordado por Habermas. Trata-se do império da racionalidade instrumental.
«En 1968, Jürgen Habermas prononce une conférence restée célèbre en l’honneur des 70 ans d’Herbert Marcuse, intitulée : « La Science et la technique comme idéologie ». Il y décrit la manière dont la rationalité instrumentale – qui a pour finalité de permettre à l’homme de disposer librement des choses – envahit le système social lui-même et, en se constituant en « idéologie », finit par asservir l’homme comme objet de cette rationalité. Autrement dit, la technique est une forme de rationalité qui a pour objectif de permettre à l’homme de maîtriser et contrôler les forces de la nature. Peu à peu, au cours de son développement, la rationalité technique échappe à sa fonction première et prend alors la forme d’une idéologie, c’est-à-dire un ensemble de valeurs au nom desquelles un certain nombre de choix sont justifiés. Elle se retourne alors vers les hommes eux-mêmes qu’il s’agira de contrôler et de maîtriser comme s’il s’agissait d’êtres de la nature ; ce que nous appelons « technocratie », c’est-à-dire, très exactement, un système de pouvoir fondé sur la technique.» (p. 130).
Vista da perspetiva da teoria crítica, há uma junção que aqui se torna crucial: o capitalismo.
«le développement des sciences et techniques modernes est corrélé au développement du système capitaliste et y prend place comme instrument d’un accroissement sans précédent des forces productives. Sciences et techniques libèrent l’homme en lui permettant de dominer les forces de la nature dans une proportion sans commune mesure avec toutes les périodes historiques qui ont précédé. Mais ce développement prenant place au sein du développement capitaliste est aussi facteur de domination de l’homme par l’homme.» p. 133
O capítulo fala também da teoria do agir comunicacional proposta por Habermas:
«il défend une spéciicité de l’interaction humaine qui repose sur le langage, sur la reconnaissance mutuelle d’intentions entre les sujets, sur l’assujettissement du sujet à des normes qui lui sont extérieures, ce qui lui permet, en retour, de discuter rationnellement du bien-fondé de ces normes.» p. 136
O autor fala também da importação de conceitos como «corpus» e do seu significado (aspeto interessante do ponto de vista da formação discursiva que se vai impondo). Refere ainda uma abordagem dos assuntos à escala humana, do mundo da vida e da sociedade.
«L’extension de la domination de la nature aux hommes même et la constitution des sciences et techniques en idéologie demandent de s’attaquer au problème contemporain d’articulation entre le progrès technique et le monde vécu social. Et c’est un projet politique : « Le pouvoir de disposer techniquement des choses ne suit pas à dissoudre la substance de la domination ; elle peut même au besoin se retrancher derrière lui. L’irrationalité de la domination qui a pris maintenant les proportions d’un danger mortel collectif ne pourrait être surmontée que par la formation d’une volonté politique, liée au principe d’une discussion générale et exempte de domination. Il n’est permis d’espérer une rationalisation de la domination que d’une situation où serait développée la puissance politique d’une pensée liée au dialogue. La force libératrice de la réflexion ne peut être remplacée par un déploiement de savoir techniquement utilisable. » p. 128-129.
Conclusion.
Les humanités aux prises avec l’idéologie numérique
O título é sugestivo e define o âmbito da conclusão. Parece que a problemática mais fundamental é a da introdução do cálculo.
«La fonction calculatoire, pour autant qu’elle soit devenue invisible aux yeux de l’utilisateur, n’a pas cessé d’être, loin de là. Elle est présente, omniprésente, et d’autant plus puissante qu’elle est invisible, évidemment.» p. 153
Fala ainda de «regimes de verdade» fundados numa grande opacidade e também do novo espírito do capitalismo digital.
«Ce qu’il s’agit d’exploiter, ce n’est plus la nature au moyen des hommes, c’est l’homme comme ressource naturelle.» p. 164.
A conclusão anda em torno do seguinte:
«En un mot, il s’agit de sortir d’une analyse purement technologique du numérique pour en restituer la portée culturelle et civilisationnelle.» p. 166.
«revendication totalitaire de la formalisation logique.» p. 169
«De ce point de vue, le développement des humanités numériques devient d’autant plus intéressant s’il croise les problématiques de la science ouverte et donc des sciences citoyennes.» p. 169
Faz também parte da conclusão a seguinte ideia:
«La « révolution numérique » qui a pu être vue comme porteuse de promesses d’émancipation révèle aujourd’hui, par déviation disent certains, par nature intrinsèque disent d’autres, un visage bien diférent, très exactement cybernétique, de contrôle des vies humaines à dessins idéologiques, politiques, économiques.» p. 174
E eis mais algumas passagens interessantes
“ Je vois maintenant que comprendre la conception des projets numériques comme instruments rhétoriques est essentiel à l’analyse critique. Si le jeu de l’imagination peut entrer dans la production et la représentation du savoir avec une certaine forme d’autorité culturelle, la manière dont nous modélisons ces projets doit inclure une compréhension d’ordre supérieur de la manière dont la logique rationnelle se légitime par instrumentalisation. Comme projet intellectuel, mon argument en faveur de l’aesthesis consiste à promouvoir et à légitimer une manière différente de penser la base de cette autorité culturelle. Le basculement d’un système logique total à des situations partielles subjectives est le cœur de cette approche. Ma discussion prend place dans un cadre de réflexion sur le numérique, mais ses implications touchent à l’héritage de la pensée logique occidentale quand elle aspire à un contrôle totalisé. Les médias numériques instrumentalisent cette logique avec un succès pervers, mais ils ne sont ni la source ni le simple effet technologique des approches formalisées.»
"La méthode critique que propose Johanna Drucker est particulièrement puissante : son originalité tient en sa capacité à remettre en cause les deux fondements de l’ordre numérique – la séparation de la forme et du fond et le formalisme logique qui lui donne une autorité supérieure à tout discours. À rebours d’une approche idéaliste, qui sépare radicalement l’idée de son incarnation en donnant à la première une supériorité ontologique incontestable sur la seconde, la chercheuse américaine propose une approche matérialiste qui s’attache à analyser les inscriptions de toutes natures dans leur multiplicité et leur variation infinie – comment elles sont engendrées et ce qu’elles engendrent. Elle passe alors du concept de représentation qui ne se conçoit que comme une dégradation – et nous sommes alors dans la longue tradition platonicienne du mythe de la Caverne –, au concept de génération qui regarde la représentation comme une action créative individuelle ou collective dont le moteur est la subjectivité des hommes.”
“Dans son livre Des miroirs équivoques, Louis Quéré a bien mis en lumière le phénomène d’interaction qui produit un monde social vécu : il s’agit d’une activité intersubjective qui ne se résume pas à la transmission d’un message encodé et “décodé entre expéditeur et destinataire (comme le modélisent les sciences de la communication que Quéré entreprend de réfuter), mais produit dans le moment même de l’échange une « réflexivité de l’échange social ». « Il n’y a pas de message sans métamessage : ou plus simplement encore, lorsque nous disons quelque chose nous disons aussi quelque chose sur ce que nous disons pour définir son mode d’emploi ou son sens. [...] Pour communiquer, nous superposons un énoncé à contenu propositionnel, qui relate une observation ou une expérience (fonction de représentation des faits), et un énoncé qui définit la relation interpersonnelle dans laquelle la signification du premier peut être comprise et acceptée.
Pour Quéré, le métamessage n’est pas un code établi a priori comme dans la théorie mathématique de la communication qui est un des fondements théoriques de l’informatique. Le métamessage n’est même pas seulement d’ordre purement linguistique. Il tient plutôt du processus de négociation dans l’échange social. Il implique non seulement une compréhension entre les sujets, mais aussi un accord entre eux et provoque d’ailleurs une « réflexivité de second niveau », dans la “mesure où l’échange social « spécifie une relation interpersonnelle en actualisant un des jeux de rôle socialement institués »18. Pour Louis Quéré, l’acte de communication n’est pas une relation à deux termes car il implique un troisième terme, qu’il qualifie de « symbolisant ». Ce troisième terme symbolisant qui est l’objet de la communication de second niveau a « quelque chose d’objectif » car il est extérieur aux deux sujets communicants. Pourtant, il n’est pas le langage lui-même comme système de signes mais relève de ce que Quéré appelle l’institution, à condition qu’on ne la comprenne pas comme donnée d’avance mais construite par l’échange.
Dans ces conditions, l’acte de communication est singulier (car il définit un accord temporaire), mais pas enfermé dans la subjectivité absolue. Il mobilise en permanence un tiers objectif par rapport auquel il se situe (Quéré parle de mobilisation d’une représentation de la « totalité sociale » qui n’est pas toujours la société globale), qu’il négocie et qu’il institue tout en même temps : « Le neutre qui fonde la communication est non pas un donné mais un construit. Il procède d’une élaboration collective permanente (non imputable à des “agents déterminés) des conditions de mise en forme du rapport social. Il est produit par une activité communicationnelle instituante19. » C’est pourquoi l’horizon de la communication est toujours social en même temps que la réalité sociale est toujours communicationnelle. Cette réalité est ce que Habermas appelle un « monde social vécu ». Or, la conduite de ces actes de communication nécessite des compétences spécifiques qui relèvent de la pratique au sens classique du terme, qui repose à la fois sur une compétence herméneutique et sur l’exercice de la faculté de juger. Ce que Bourdieu appelle « sens pratique”».
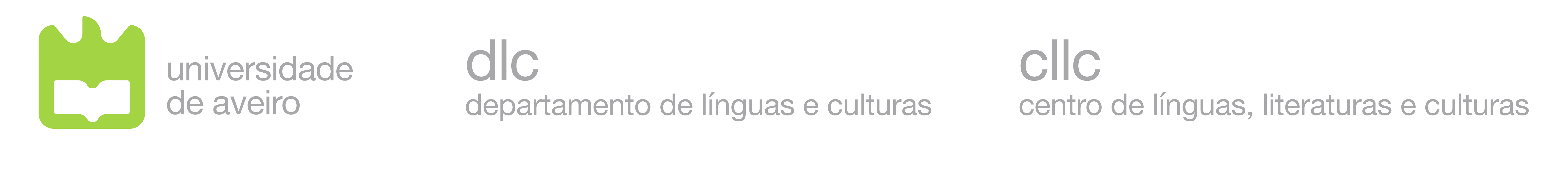
Última atualização em 30 de novembro de 2025